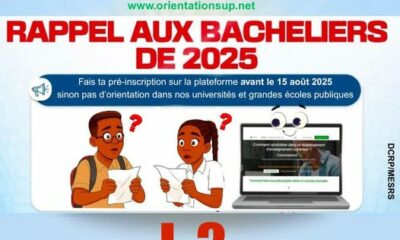Enseignement Supérieur
15e Salon International du livre d’Abidjan : Prof. Adama Coulibaly dissèque le thème de la rencontre

Enseignement supérieur, D’où viennent les livres ? Que racontent-ils de notre histoire, de notre mémoire, de nos blessures ? À l’occasion de la 15e édition du Salon International du Livre d’Abidjan (SILA), il est revenu à Professeur Adama Coulibaly, Directeur de l’Unité de Formation et de Recherches Langues, Littératures et Civilisations (UFR LLC) de l’Université Félix Houphouët-Boigny de prononcer la conférence inaugurale sur la thématique générale du salon : « Livre Racines ». Un propos inaugural qui a posé, d’emblée une question centrale : celle des racines du texte.
En écho à Borges et son étrange personnage de Pierre Ménard, qui tente de réécrire Don Quichotte sans jamais lire Cervantès, Prof. Adama Coulibaly a rappelé qu’aucun livre n’est vraiment seul et que tous les écrits livresques plongent leurs racines dans d’autres textes, dans des histoires lues, vécues ou transmises.
Le livre, pris comme un corps vivant.
Ni simple objet, ni pure parole, le livre est un corps complexe, fait de papier, de mémoire et de langage. Il est tissage, comme l’a rappelé à juste titre Prof. Adama COULIBALY, citant fort à propos la mythologie Grecque : Tiresias, aveugle voyant, accède à la vérité après avoir vu le corps nu d’Athéna – corps lui-même couvert de textes. En Afrique, cette image du tissage résonne avec les contes de l’araignée Ananzé et la toile comme symbole de totalité. Écrire, c’est donc aussi tenter de dire le monde, de le capter, de le traduire, dans une langue qui est elle-même enracinée dans le vécu, les sensations, la culture.
Des livres qui naissent d’autres livres
À travers de nombreux exemples qu’il a cités – d’Ahmadou KOUROUMA à Sandrine BESSORA, d’Aimé Césaire à Patrick CHAMOISEAU – Prof. Adama COULIBALY a montré, dans sa réflexion que chaque livre est la résonance d’un autre. Ainsi existe-t-il les livres de l’enfance, lus en cachette, les livres intimes nés de douleurs, de révoltes, ou même de prison. Il y a également les livres « endormis » : ceux qu’on garde sans raison, mais qui un jour, réveillent en nous une mémoire enfouie.
Certains auteurs écrivent, a-t-il rappelé, à partir d’une faille, personnelle ou collective. « La colonisation, l’esclavage, les guerres, les génocides ont laissé des cicatrices que la littérature tente de raccommoder. D’où cette métaphore filée de la couture : écrire, c’est recoudre ce qui a été déchiré », a-t-il indiqué.
Dématérialisation
Mais les racines du livre ne sont pas qu’historiques ou littéraires, a nuancé le conférencier. Aujourd’hui, à l’ère des écrans, le livre se dématérialise, se réinvente. Il devient hypertexte, parfois collaboratif, et entre même dans l’univers de l’intelligence artificielle. Certains crient à la fin du livre. D’autres y voient une nouvelle germination, une manière de ré-enraciner autrement les textes dans l’expérience du monde.
Lire, un acte de résistance
Plus que jamais, le livre vit par la lecture. C’est elle qui lui donne sens, souffle, mouvement. Dans un monde saturé d’images et de vitesse, lire devient un acte de résistance, un retour à la profondeur. Le livre reste ce fragment de culture, cette trace de vie, cette racine vivante qui relie passer et avenir.
Ce 15e Salon International du Livre d’Abidjan invite en définitive à revenir aux sources, à ces points d’ancrage visibles ou souterrains qui nourrissent l’acte d’écrire – et, plus encore, l’acte de comprendre.



Source : ufhbci